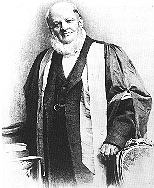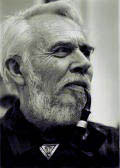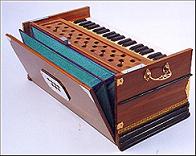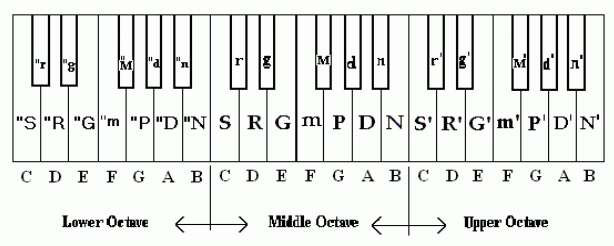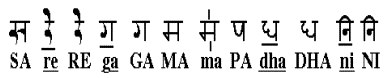|
***RaDio TEENTAAL***
L'
EVASION AUX SAVEURS INDIENNES !
|
| retour
à la page zéro
|
| Auteur |
Message |
Miss_Diey
Teentaalien VIP
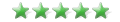
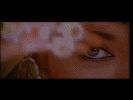
Inscrit
le: 27 Aoû 2005
Messages: 1540
Localisation:
Marseille
|
 Posté le: Sam Avr 08,
2006 9:26 pm Sujet du
message: Posté le: Sam Avr 08,
2006 9:26 pm Sujet du
message: |
|
|
ok, merci pour la précision

_________________
Today:
I'm Diey Akhsay Kumar 
My skyblog:
http://bollymania.skyblog.com/ | |
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
 Posté le: Dim Avr 09,
2006 1:35 am Sujet du
message: 9 - 6 Posté le: Dim Avr 09,
2006 1:35 am Sujet du
message: 9 - 6 |
|
|

8 - 6 : Quelques théoriciens de la
musique
AVANT
J-C.
Pythagore
de Samos (- 570 / - 480)
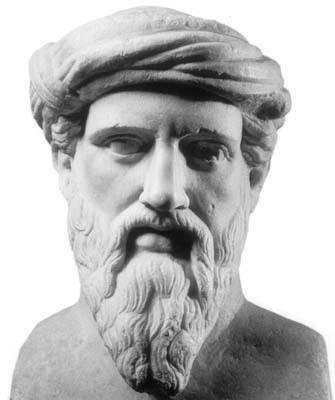
L’essentiel de ce
qu’il y a à connaître des pythagoriciens, est ici
(en
anglais) :
http://www.myastrologybook.com/Pythagoras-music-of-the-spheres.htm
Pour en savoir plus, fouiller (c’est en français):
http://www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/histoire/
à Tarente (Italie), 2 disciples de Pythagore :
Philolaos, puis Archytas : voir http://bcs.fltr.ucl.ac.be/fe/06/Archytas.html
Aristoxène de
Tarente ( IV° siècle av. J-C.)

écrivit 453
livres, dont Eléments
harmoniques et Eléments rythmiques.
APRES J-C.
Claude
Ptolémée, d’Alexandrie ( ca. 90 – ca. 168 )
nous a
laissé un traité intitulé Harmonies
C’est une
étude mathématique des sons dans la musique grecque,
une
synthèse des travaux de Pythagore et d’Aristoxène
Boèce (480 –
ca. 525), consul de Rome sous Théodoric, roi des Wisigoths,
est le savant par qui nous connaissons l’œuvre de
Pythagore
Gui
d’Arezzo (ca : 990 - 1050), moine toscan, a écrit, vers 1025,
le micrologue .
C’est à lui qu’on doit la portée, qui fut d’abord
à 4 lignes.
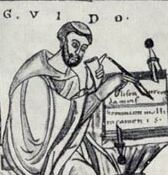
http://www.herodote.net/10500517.htm
Gioseffo
Zarlino (1517 - 1590) , dit Zarlin
est l’auteur de
Les institutions
harmoniques, ouvrage publié en 1558 à Venise
( en
italien : Le institutione
harmoniche )
http://sonic-arts.org/monzo/zarlino/1558/zarlino1558-2.htm
(pour se faire une idée : traduction partielle, avec
figures, & commentaires en américain)
Olivier Bettens
indique que Zarlino s’appuya sur Ptolémée
Ici (doc. en
italien), on voit bien qu’Aristoxène (au moins indirectement)
inspira Zarlino :
http://users.unimi.it/~gpiana/dm3/dm3ari01.htm
Zarlino écrivit d’autres livres (voir l’une des
bibliographies ci-après.)
Anselme de Flandres, fixa,
dit-on la valeur du SI, peut-être en 1587, en tous cas au
XVI°.
On dit qu’il fut élève d’Hubert Waelrunt, d’Anvers,
[ca 1517 – 1595]. On lit aussi que c’est Waelrunt qui donna
son nom au SI, ailleurs que c’est Lemaire, un Français.
Marin Mersenne
(1588 - 1648)
 écrivit le Traité de l’harmonie
universelle écrivit le Traité de l’harmonie
universelle
Biographie : http://www.musicologie.org/derm/mersenne.html
Voici ici une page de son traité consacrée à la facture
d’orgues, commentée par un amateur
http://perso.wanadoo.fr/organ-au-logis/Pages/Mersenne/Mersenne15.htm
Jean-Marie Bononcini, violoncelliste italien (1642 -
1678) http://www.califice.net/pourquoi/language.shtml#2
publie en 1673 « Musico
prattico » . Il y remplace UT par DO en 1673
http://www.baroquemusic.org/bqxbononci.html
Andreas
Werckmeister (1645 - 1706), organiste allemand,
est
le théoricien à qui, je pense, nous devons le tempérament égal
(1691)
http://www.musicologie.org/publirem/jmw/notices/werckmeister_andreas.html
http://emc.elte.hu/~pinter/werck.html
N.B. Le clavier bien tempéré, de
Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750),
est un recueil de
pièces pour clavecin.
http://infopuq.uquebec.ca/~uss1010/catal/bacjs/bachbio.html
Joseph Sauveur
(1653 - 1716),
physicien français qui naquit sourd et qui
est le fondateur de l'acoustique,
est l'auteur à qui on
doit
-- Principes
d'acoustique et de musique,
in : Mémoires de
l'Académie des sciences, 1701, 68p.
-- Application des sons harmoniques à
la composition des jeux d'orgues. in : Mémoires de
l'Académie des sciences, 1702.
-- Méthode générale pour former des
systèmes tempérés en musique,
in : Mémoires de
l'Académie des sciences, 1707
(sources :
http://members.aol.com/fichet/biblio.html
http://www.musicologie.org/Biographies/s/sauveur_joseph.html
)
Sur les rapports entre les mathématiques et la
musique (et pour apporter de l'eau au moulin de Cinthy  -
vive elle, ma défenderesse -
vive elle, ma défenderesse  !) !)
voir cet article
consacré à la correspondance de Leibniz à ce sujet, entre
1706 et 1712 :
http://fiorano.u-strasbg.fr/lexis/html/cinscription/Leibniz.html
Jean-Philippe
Rameau (1683 - 1764)

publia
en 1722 le Traité de
l’harmonie réduite à ses principes naturels
mais il
poursuivit ensuite ses études et publications
http://www.hoasm.org/VIIF/Rameau.html
Jean-Le Rond
d’Alembert (1717-1783)

écrivit un manuel
de vulgarisation de l’oeuvre de Rameau,
Eléments de musique théorique et
pratique,
dont Condillac approuva le manuscrit en
novembre 1751 et qui fut édité à Paris en 1752.
Ce manuel
est l’une des bases du présent exposé.
D’Alembert fut
secrétaire perpétuel de l’Académie française. Sa vie est
racontée ici :
http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=219
Giuseppe
Tartini (1692 - 1770 ), Italien,

publia
Trattato di musica secondo la
vera scienza dell'armonia, à Padoue, en 1754
http://istrianet.org/istria/illustri/tartini/
ainsi qu'un "traité des agréments" (i.e. un traité de
l'ornementation), présenté ici (en anglais) :
http://www.geocities.com/conniesunday/tartini.html
Hermann von
Helmholtz (1821 – 1894)

médecin et
savant allemand, s’intéresse à la vue et à l’ouïe et publie,
en 1862
Die Lehre von den
Tonempfindungen
als physiologische Grundlage für die
Theorie der Musik
[littéralement :
les leçons
des découvertes sur les tons
en tant que fondements
physiologiques pour la théorie de la musique]
Une version
en français paraît à Paris en 1868 sous le titre
Théorie physiologique de la musique
fondée sur l’étude des sensations auditives
Pour en
savoir plus sur Helmholtz, sa vie, son œuvre :
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Hermann_von_Helmholtz
Alexander John
Ellis (1814-1890)
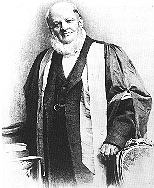
phonéticien anglais,
traduisit en anglais, et annota la théorie de Helmoltz
http://encyclopedia.jrank.org/fr/ECG_EMS/ELLIS_lorigine_SHARPE_ALEXANDER.html
Son travail ne fait pas l’unanimité ! (Voir aussi http://www.greenwych.ca/sherlock.htm )
Il invente le « cent » et en montre l’intérêt dans son
appendice 20 ( 126 pages ) à la version anglaise du livre de
Helmholtz
On the
Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of
Music
Voir http://www.music-cog.ohio-state.edu/Music829F/Biographies/Helmholtz.html
Sur l’histoire des subdivisions de l’octave et les autres
intervalles petits (tels le « cent »),
voir http://www.xs4all.nl/~huygensf/doc/measures.html
Un autre portrait de lui (déjà donné plus haut) :
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/BigPictures/Ellis_Alexander.jpeg
James Murray
Barbour
docteur en physique et musicologue, publia,
en 1932
Equal temperament
: its history from Ramis (1492) to Rameau (1737).
et d’autres ouvrages
Voir aussi http://www.medieval.org/emfaq/zarlino/arnotes.html
, notes 17, 20 et 21.
et cette bibliographie :
http://www.fi.muni.cz/~qruzicka/BIBL2.htm
Harry
Partch (1901 - 1974), Américain,
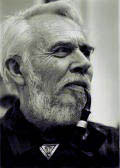
écrivit Genesis of a music.
1ère édition : 1947 ?
(J'ai lu ça mais ça
m'étonne, je croyais qu'elle était de 1932).
 Tiens, Biren, ce livre est publié chez Da Capo Press à
New-York.
Tiens, Biren, ce livre est publié chez Da Capo Press à
New-York.
Cet éditeur a publié plusieurs livres sur la
théorie de la musique :
profite d'y faire un tour pendant
que tu séjournes là-bas ! 
Sur l’œuvre
d’Harry Partch et des ses successeurs,
sur « l’intonation
juste » et les micro-tons, voir http://sonic-arts.org/
(c'est une
encyclopédie !).
Sur la page d'accueil, la photo de
Harry Partch que j'ai déjà publiée
(à moins que ce ne fut
en février et que Kali l'eût effacée ?)
http://sonic-arts.org/partch.jpg
Un
lecteur pressé ira d'abord ici : http://www.corporeal.com/
Une
biographie d'H. Partch est ici (1 page en anglais)
http://cctr.umkc.edu/user/amcdonald/partch.html
Voici un présentoir des bouquins de ces auteurs
contemporains
(Barbour, Partch et d'autres), en anglais
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/030680106X/corpormeadowtheo/002-3621997-2812001
Cliquez sur le livre de Partch pour avoir les détails ! Le
fac-similé de la table des matières, celui du 1er chapitre
(lequel m’inspira le début de la 1ère version de cet exposé,
détruite, qui commencait par l’exposé d’une décision prise par
un empereur de la Chine antique)...
Voici une page de
présentation de Partch et des instruments qu'il a inventé
http://www.composerjohnbeal.com/Partch.html
(inventer des instruments, c'était ça, au fond, sa
passion) :
http://musicmavericks.publicradio.org/features/feature_partch.html
Evidemment, il y a aussi http://www.harrypartch.com/
Etc.
Olivier
Bettens
http://virga.org/ puis choisir : d’abord
Zarlino, puis Robin et Marion.
Monsieur Bettens est notre
contemporain. Il vit en Suisse. Il est très sympa.
Nameeta Shah
C'est une page de son mémoire de fin d'études de
l'Université de Kanpur qui est ma source la plus fiable sur
les shrutis et sans laquelle je n'aurais pas pu faire cet
exposé.
Merci, Nameeta ! 
Après s'être
intéressée à la conception d'un logiciel d'animation graphique
piloté par de la musique et qui en fasse voir la couleur,
Nameeta a travaillé -- et travaille encore --dans le génie
génétique.
Compléments :
Sur Ramis (1482), Sauveur (1700) et autres auteurs,
voir cette bibliographie chronologique
consacrée aux seuls
livres traitant du tempérament égal ! http://home.earthlink.net/~splarfage/paper/bib.doc
Le début de l’histoire (XV°) est ici, en anglais, sur ce
bloc-notes brésilien :
http://brasilnuts.blogspot.com/2005_10_14_brasilnuts_archive.html
L’eesntiel de la proposition de Ramis est ici :
http://sonic-arts.org/monzo/ramos/ramos.htm
Sur les similitudes entre les conclusions de
Bartolomeo Ramis et de ceux de Safi-Al-Din, musicien arabe,
voir http://www.chrysalis-foundation.org/Al-Din_&_Ramis.htm
Christian Huygens (1629 - 1695) s’intéressa aussi à la
subdivision de l’octave et proposa de la tronçonner en une
trentaine de parties.
Voir : http://www.music.indiana.edu/tfm/17th/HUYCYC_TEXT.html
- C'EST
EN FRANCAIS !
Synthèse pouvant être utile à
tout compositeur, l''article que voici, intitulé HARMONIE :
http://www.cartage.org.lb/fr/themes/Arts/musique/musiq/Harmonie.html
Dernière édition par Veit le Ven Nov
03, 2006 1:03 am; édité 4
fois | |
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
 Posté le: Dim Avr 09,
2006 12:43 pm Sujet
du message: 9 - 7 Posté le: Dim Avr 09,
2006 12:43 pm Sujet
du message: 9 - 7 |
|
|
9 - 7 harmonium
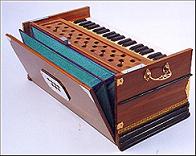
source de
l'image = http://www.andrew.cmu.edu/user/ssubram1/articles/harmonium.html
(contient, expliqué en 1 ligne, le principe des fameuses
sruti boxes !)
L'harmonium portatif est le successeur de l'orgue
positif du Moyen Âge
(dit "positif" car.... on le pose sur
une caisse pour en jouer.
C'est un instrument
transportable -- ou fixe s'il est imposant,
tel celui dont
il reste les vestiges dans la chapelle du château d' Ecouen
(Val d'Oise) ; la caisse est caisse de résonance).
Voici une page qui vous présente plusieurs modèles
d'harmoniums portatifs et qui atteste que c'est un instrument
de la musique indienne.
Et des échantillons sonores sont
disponibles sur cette page
http://www.indianmusicalinstruments.com/harmonium2.htm
Je me souviens d'un spectacle de danse Ossidi donné à
la ferme du Buisson à Noisy-le-Grand dans les années 90.
L'éclairage était horrible : orangé d'un bout à l'autre du
spectacle.
L'harmonium servait à
réaliser un bourdon (un peu comme font les Irlandais avec leur
Uilleann pipes). Il
était servi par 2 personnes, l'une au clavier et l'autre au
soufflet.
L'harmonium, donc, est utilisé dans la
musique traditionnelle indienne.
(Et ce depuis le XIX°
siècle)
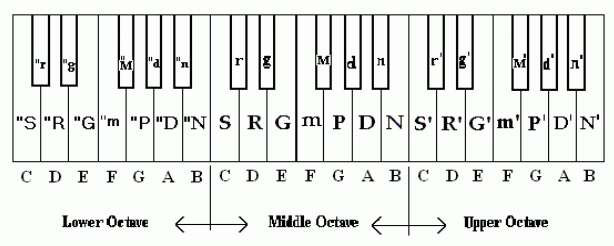
Voici un cours gratuit
d'harmonium (en anglais) : http://www.soundofindia.com/
Dernière édition par Veit le Ven Nov
03, 2006 1:08 am; édité 3
fois | |
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
 Posté le: Dim Avr 09,
2006 1:25 pm Sujet du
message: 9 - 8 Posté le: Dim Avr 09,
2006 1:25 pm Sujet du
message: 9 - 8 |
|
|
9 - 8 septain diatonique
On
peut donc définir ansi les
swaras du saptak
(c'est-à-dire les notes du
septain) :
SA = 0
RI = 200
points
GA = 400
MA = 500
PA = 700
DHA = 900
NI = 1100
et on recommence à
sa = 1200
--> tivra =
monter de 100 points
(exemple : MA TIVRA = 600 points)
--> komal =
descendre de 100 points
(exemple : RI KOMAL = 100 points)
Maintenant, nous allons considérer les points de
départ de ces échelles régulières : SA = 240 Hz dans l'échelle
de Nameeta Shah ;
Do = 261 Hz ou environ en musiqe occidentale,
ce qui fait -- je me répète -- qu'on a des univers musicaux
parallèles et semblables mais qui n'ont aucun son en commun.
On passera ensuite à l'étude d'échelles
irrégulières.
Dernière
édition par Veit le Ven Nov 03, 2006 1:09 am; édité 2
fois | |
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
 Posté le: Lun Avr 10,
2006 10:40 pm Sujet
du message: 9 - 9 - a Posté le: Lun Avr 10,
2006 10:40 pm Sujet
du message: 9 - 9 - a |
|
|
9 - 9 : sa

D'après ce que j'ai lu, en musique indienne :
- le
point de départ de l'échelle ascendante est toujours un sa ;
-
cette hauteur est convenue entre les musiciens avant qu'ils ne
commencent à jouer ensemble ;
- dans la page dont j'ai
donné la référence plus haut, relative au sitar, l'auteur a
choisi pour hauteur de son sa la même
hauteur que l'un de nos si ;
-
posant sa = 240 Hz,
Nameeta Shah a choisi une hauteur comprise entre un si et un si b ;
-
et un sitariste teentaalien qui joue avec du sitar avec un
comparse qui sonne de la veuze (une cornemuse nantaise) dit
accorder son instrument en "do relatif" ...
Dernière édition par Veit le Ven Nov
03, 2006 1:10 am; édité 3
fois | |
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
 Posté le: Mer Avr 12,
2006 10:50 pm Sujet
du message: 9 - 9 - b Posté le: Mer Avr 12,
2006 10:50 pm Sujet
du message: 9 - 9 - b |
|
|
Au point où nous sommes
arrivés, vous pouvez maintenant lire avec profit cette page-ci
qui vous présente le septain (saptak)
et la gamme
diatonique (les 8 notes de l'octave ; ashtak) ainsi que la notation
des notes intermédiaires
une note = un swara ;
une note soulignée = un swara altéré d'une altération
komal
une note surlignée = un swara altéré d'une
altération tivra
(autre notation : une apostrophe à côté
du nom de la note, en haut et à droite ;
ou bien au-dessus
-- comme sur l'image ci-après ;
L'Australien Bob Smith écrit RE là
où nous écrivons RI ;
la même note a 2 noms selon la
région.
Même chose : notre SI, des anglophones l'appellent
TI.)
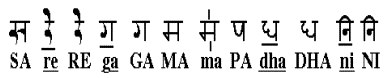
http://musique.indienne.free.fr/inde1.html
L'article présente aussi les thaat c'est-à-dire un jeu de
notes pris d'avance dans l'échelle et que le compositeur
assemblera pour composer son morceau
(en principe à
l'exclusion d'autres notes ; telle est la règle qu'il
s'imposera).
Dernière
édition par Veit le Ven Nov 03, 2006 1:10 am; édité 6
fois | |
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
|
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
 Posté le: Ven Avr 14,
2006 12:13 pm Sujet
du message: 9 - 10 Posté le: Ven Avr 14,
2006 12:13 pm Sujet
du message: 9 - 10 |
|
|
9 - 10 : du diapason

Dernière édition par Veit le Ven Nov
03, 2006 1:12 am; édité 2
fois | |
 |
toonssia
Teentaalien VIP
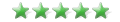
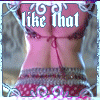
Inscrit
le: 30 Aoû 2005
Messages: 985
|
 Posté le: Ven Avr 14,
2006 12:41 pm Sujet
du message: Posté le: Ven Avr 14,
2006 12:41 pm Sujet
du message: |
 |
|
ah le diapason !!
beaucoup de physique qui s'y cache la dedans looooool
avis aux amateurs  | |
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
 Posté le: Ven Avr 14,
2006 3:25 pm Sujet du
message: 9 - 10 - a1 Posté le: Ven Avr 14,
2006 3:25 pm Sujet du
message: 9 - 10 - a1 |
|
|
 Lol !
Toonssia ! Pas trop de physique mais un peu d'histoire,
comme tu vas voir ! Lol !
Toonssia ! Pas trop de physique mais un peu d'histoire,
comme tu vas voir !
Le diapason, c'est cette petite
fourche dont on tient la queue dans une main et qu'on frappe
sur l'autre main pour en faire vibrer les branches. On porte
alors l'instrument à l'oreille et on entend alors un petit son
ténu, sans harmoniques et dont la fréquence est la fréquence
de vibration des branches.
Le diapason est réalisé de
manière à produire un son de fréquence stable et fixe qui est
une fréquence conventionnelle de référence, fréquence qu'on
appelle aussi... le diapason !
Le diapason a été
inventé en 1711 par un Anglais qui s'appelait John Shore et
qui jouait du luth.
Si on fait entrer le diapason en
vibration et qu'on pose l'extrémité de la queue de celui-ci
sur un meuble, celui-ci fait caisse de résonance. La vibration
du diapason se transmet au bois du meuble, puis à l'air
contenu dans le volume du meuble, puis à l'air ambiant. Le son
qu'on entend est plus fort.
La valeur de la fréquence
conventionnelle de référence a été publiée en 1955 par l'ISO,
organisme international de normalisation. La recommandation
ISO / R 16 - 1955 a obtenu le statut de norme internationale
en 1975, après consultation du comité technique ISO/TC 43 par
le secrétariat central de l'ISO à Genève. La "fréquence d'accord normale"
(tel est son nom) est donc spécifiée par la norme internationale ISO 16 -
1975.
Voici l'essentiel de cette norme (je l'ai sous
les yeux) :
- " La fréquence d'accord normale est la
fréquence de la note la3 et elle est fixée
à 440 Hz".
-
Respecter cette fréquence le plus rigoureusement possible lors
de l'accord des instruments de musique.
- Pour
l'accord et le réaccord, disposer d'instruments produisant la
fréquence normale d'accord avec une précision de plus ou moins
0,5 Hz.
- Fabriquer les instruments de musique de
façon que, à la température et dans les conditions fixées par
le fabricant, il soit possible de les accorder suivant la
fréquence normale de 440 Hz
(Dans ce but, les fabricants
peuvent trouver désirable de disposer de diapasons donnant
cette fréquence avec ue précision supérieure ou églae à 0,25
Hz).
On peut se
procurer les normes internationales auprès de l'ISO à
Genève ( http://www.iso.org/ )
mais aussi auprès des Instituts
nationaux de normalisation qui sont membres de l'ISO, en
France l'AFNOR - c'est là que je travaille - http://www.afnor.org/ -- , en Belgique
l'iBN, etc.).
Dernière édition par Veit le Ven Nov
03, 2006 1:16 am; édité 3
fois | |
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
 Posté le: Ven Avr 14,
2006 4:04 pm Sujet du
message: 8 - 10 - a2 Posté le: Ven Avr 14,
2006 4:04 pm Sujet du
message: 8 - 10 - a2 |
|
|
Sauf exceptions, les normes
sont de libre application.
A ce que j'ai lu, la
fréquence de référence utilisée dans les conservatoires de
musique de France est : 444 Hz
Si vous faites le
calcul, vous trouverez que cette fréquence est de 16 points
(16 cents) supérieure
à la fréquence normalisée, soit moins d'1 comma. | |
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
 Posté le: Ven Avr 14,
2006 4:33 pm Sujet du
message: 8 - 10 - a3 Posté le: Ven Avr 14,
2006 4:33 pm Sujet du
message: 8 - 10 - a3 |
|
|
Ce document anglais ( http://www.uk-piano.org/history/pitch.html )
laisse entendre que la norme internationale de 1955 se serait
alignée sur la norme américaine d'avant-guerre. Toutefois, les
USA ne font pas partie des 17 pays ayant approuvé la
recommandation de 1955.
Par contre, on y trouve
mention tout à fait vraisemblable d'un la3 de 435,4 Hz adopté à
Vienne en 1885.
Cette valeur était toute proche de
celle qui était en vigueur en France et qui avait été fixée
par arrêté ministériel sur la base d'un rapport présenté le
1er février 1859 à un ministre d'Etat par une commission qui
comprenait, entre autres personnalités le physicien Lissajous
et les musiciens Meyerbeer et Berlioz. Cet arrêté adoptait un
diapason normal obligatoire pour tous les établissements
musicaux de France autorisés par l'Etat. Celui-ci était de 870
vibrations par seconde.
Etant donnée la façon de
s'exprimer de l'époque, ça correspond à : la3 = 870 / 2 = 435 Hz
(diapason national français de 1859).
La page internet
que je viens de vous donner vous donne d'autres valeurs du
diapason, variables selon les lieux et les époques.
Au temps
de Napoléon, le diapason de l'armée russe n'était pas le même
que celui de la grande Armée.
Du temps de Louis XIV,
notre diapason (le la
de l'époque, donc) correspondait à peu près à un sol de maintenant --
c'est
ce que m'a dit une fois un joueur de viole de gambe de la Cité
de la musique, à Paris.
Le sol de maintenant, pour un
la de 440 Hz, c'est 392 Hz.
Voici d'autres chiffres
tirés d'une encyclopédie où l'auteur emprunte à Grove qui a
lui-même emprunté à Ellis.
1636 : ton de chambre
(d'après le frère Mersenne) : 563 Hz
1636 : ton de
chapelle (d'après le frère Mersenne) : 504 Hz
1648 :
accordage de l'épinette (d'après Mersenne) : 403 Hz
1700 :
diapason moyen de Paris : 404 Hz.
Aujourd'hui : la3 adopté par plusieurs
orchestres baroques : 415 Hz.
1751 : diapason de
Haendel : 423 Hz
1780 : diapason de Mozart : 422 Hz.
1810 : diapason moyen de Paris : 423 Hz.
1834 :
congrès de Stuttgart : 440 Hz
1859 : diapason français
: 435 Hz
mais....
1856 : opéra de Paris : 459 Hz
(rappel : la commission qui avait préparé l'arrêté
minstériel de 1859 avait pour mission de réagir contre
l'élévation excessive du diapason)
1859 : congrès de
Vienne : 456 Hz
1863 : Helmholtz (Tonenpfindungen) : 440 Hz
1879 : pianos Steinway (U.S.A.) : 457 Hz
1885
: conférence de Vienne : 435 Hz
1899 : Covent garden
(c'est à Londres) : 440 Hz
1939 : diapason
international normal : 440 Hz
1953 : conférence de
Londres : 440 Hz
1955 : recommandation ISO R/16 : 440
Hz
1975 : norme internationale ISO 16 : 440 Hz
De 440 Hz à 435 Hz, il y a 20 points
De
440 Hz à 415 Hz, il a 101 points.
Dernière édition par Veit le Sam Avr
22, 2006 12:37 pm; édité 1
fois | |
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
 Posté le: Ven Avr 14,
2006 9:48 pm Sujet du
message: 8 - 10 - b1 Posté le: Ven Avr 14,
2006 9:48 pm Sujet du
message: 8 - 10 - b1 |
|
|
D'où vient le choix de ce
la, comme note de
référence ?
On dit que c'est parce que c'est la note
qui est au milieu de l'étendue du grand orgue.

Orgue de 1985, de l'église
luthérienne St-Etienne, d'Echerterdigen
(Allemagne),
accordé selon le tempérament proposé par Neidhardt en
1729.
Mais le la était déjà la note du
milieu de la gamme byzantine.
N.B. V. aussi
--> http://www.cyberonic.com/~mark7/tunings.html
--> http://diapason.xentonic.org/who/Neidhardt.html | |
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
 Posté le: Ven Avr 14,
2006 10:18 pm Sujet
du message: 8 - 10 - b2 Posté le: Ven Avr 14,
2006 10:18 pm Sujet
du message: 8 - 10 - b2 |
|
|
Voici une échelle de la
musique byzantine. "Elle part du degré supérieur, selon
l’usage antique"
α
(a)________________________Lune_____ré
ε
(é)________________________Mercure___do
ι (i), degré
mobile,_____________Vénus____si b
ο
(o)________________________Soleil_____la
η
(ê)________________________Mars_____ sol
ν
(y)_________________________Jupiter____fa
ω
(ō)________________________Saturne___mi
«Cette échelle
offre l’une des formes de l’octave dorienne archaïque
avec
mi pour base et la pour mèse, note moyenne ou teneur
».
in La
musique des origines à nos jours, Librairie Larousse, Paris,
1947.
Ceci indique que les organistes, prenant le
la comme note milieu
de leurs instruments, ont suivi un usage très
ancien.
Dernière édition
par Veit le Ven Avr 14, 2006 10:36 pm; édité 2
fois | |
 |
Veit
Teentaalien confirmé


Inscrit le: 25 Nov
2005
Messages: 409
Localisation: Tremblay (93)
|
 Posté le: Ven Avr 14,
2006 10:32 pm Sujet
du message: 8 - 10 - b3 Posté le: Ven Avr 14,
2006 10:32 pm Sujet
du message: 8 - 10 - b3 |
|
|
Une conséquence de cela,
c'est que, comme c'est la qui est la fréquence de
référence, et que c'est do que nous avons pris comme
point de départ de l'échelle, il nous faut, l'échelle étant
donnée (chromatique à tempérament égal comme on l'a vue
jusqu'à présent, ou à tempérament inégal comme on le verra par
la suite) mais l'échelle partant du do, soit re-calculer la
fréquence relative de toutes les notes de l'échelle à partir
du do, pour pouvoir les
apprécier par rapport au la, soit dans un premier
temps calculer la fréquence du do, le rapport entre la et do étant connu par définition
de l'échelle, puis dans une deuxième temps calculer toutes les
fréquences par rapport à ce do.
La 2ème méthode
est plus simple. La 1ère est plus précise.
Dernière édition par Veit le Sam Avr
15, 2006 11:16 am; édité 1
fois | |
 |
|

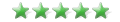
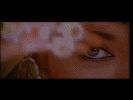














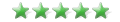
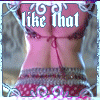












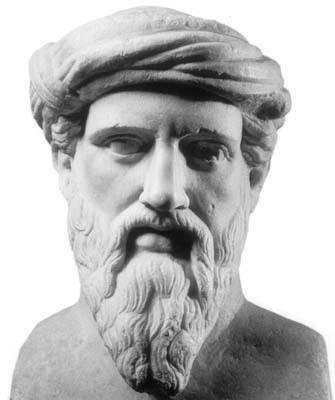

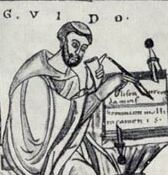
 écrivit le
écrivit le